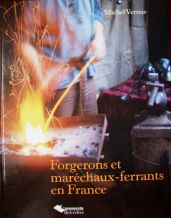
Pour en avoir plus
Comment le forgeron auxiliaire des dieux, voire dieu lui-même est-il devenu le maître de forge du village, puis plus récemment le mécanicien des machines agricoles, et aujourd’hui le maréchal ferrant nomade ou le sculpteur en ferronnerie ?
Le forgeron rural est au cœur de la grande aventure métallurgique de l’histoire humaine. Une histoire qui se développe sur 5 000 ans. Il est également au cœur de la longue histoire du monde agricole auquel il a été lié si étroitement et si intimement.
En vérité, le forgeron au village est l’homme à tout faire, l’homme indispensable. Il ferre les animaux et les soigne, fabrique et répare les outils, travaille sur les roues et les voitures, entretient les engins agricoles, effectue à la demande tous les menues travaux dont la communauté villageoise a besoin.
Pendant plusieurs millénaires, lieu d’une science occulte, la forge est devenue dans la période moderne un « art ». Les objets forgés sont présents dans toutes les demeures, aussi bien comme ustensiles que comme ouvrages d’art. Depuis le XVIIe siècle, la fabrication et le métier évoluent peu jusqu’au début du XXe siècle. C’est l’époque où s’impose l’image populaire du forgeron martelant une pièce rougie au feu sur son enclume, entouré d’étincelles, tel Vulcain dans son atelier magique et noir.
Dans cet ouvrage, les évolutions techniques, économiques, sociales d'un métier, qui a été la clé de voûte du monde rural, sont suivies à la trace, tout en portant une grande attention aux éventuels particularismes régionaux.
Le forgeron au village
Les humbles tiennent rarement la plume: ils ne sont le plus souvent connus que parce que d'autres ont écrit à leur place. Parfois cependant, du silence, une voix s'élève, d'autant plus précieuse qu'elle est rare ; et ce, plus particulièrement quand elle vient du monde paysan. Voici une de ces voix, celle de Jean-Claude Mercier, laboureur de Mamirolle (à 15 kilomètres de Besançon), qui vit de 1680 à 1772. Ses descendants conservent son « livre de raison», rédigé entre 1740 et 1760. Villageois aisé, il aspirait de toute évidence à devenir quelqu'un, et il fut effectivement une petite notabilité locale : propriétaire aisé, trésorier d'une confrérie, garde-étalons pour les haras de Besançon... Cette dernière fonction, acquise il est vrai difficilement, lui donne dans le canton la parcelle d'autorité ardemment souhaitée.
Heureusement pour nous, lecteurs d'aujourd'hui, il n'inscrit pas seulement sur le papier la recette et la dépense - la dépense surtout. Il laisse sa plume s'évader parfois au-delà de la simple comptabilité domestique qu'il s'efforce de tenir à jour pour conduire la grande famille qui vit sous son toit. Il note dans les interstices de ses notes quelques événements familiaux, consigne les faits notoires dans son village et aux alentours.
On y trouve l’évocation de la vie quotidienne d'un riche laboureur dans son village, de ses préoccupations matérielles, de sa vie familiale, de ses activités dans la paroisse, de sa recherche de notabilité ... On y trouve aussi parfois les échos de la lointaine politique du royaume.
Une vie paysanne en Franche-Comté
Les rapports complexes et souvent contradictoires dans l'ancienne France des populations villageoises et du curé sont ici racontés sur le vif.
Au travers des chicaneries, des récriminations et procès surgissent tous les aspects de la vie villageoise. Le curé n'est-il pas dans la paroisse l'homme a tout faire ? Aussi les occasions de con£lit ou au contraire les manifestations, de confiance ne manquent-elles pas; mœurs et vie familiale, vie associative et religieuse, communauté et jeu des pouvoirs au village ... Partout le curé déploie un large interventionnisme, il est alors accepté comme protecteur ou rejeté comme un intrus. C'est selon. Les curés empêcheurs de danser en rond sont brocardés.
L'ouvrage tient compte bien entendu de la très grande diversité des provinces du royaume : de la Bretagne à la Provence en passant par le Périgord, l'Auvergne, la Bourgogne ou encore le Lyonnais, sans oublier la Franche-Comté que l'auteur connaît plus particulièrement.
L’irrésistible autorité du curé sans être véritablement contrée suscite, avec des nuances régionales, une volonté d'autonomie des populations et pourtant dans le même temps la présence protectrice du prêtre est revendiquée.
Ainsi se joue au village un épisode de notre vie rurale, raconté simplement et de façon vivante. On ne trouvera pas ici une histoire au sommet, mais un récit à fleur de terre... au pied et à l'ombre du clocher.
Le presbytère et la chaumière
La veillée
Les veillées d’autrefois, c’était longtemps avant la télévision, bien avant la radio, bien avant l’électricité. On s’en souvient avec beaucoup de mélancolie…comme d’un moment magique, un moment de bonheur transmis avec nostalgie par les anciens à la recherche du paradis de leur enfance.
La veillée, oui, mais quelle veillée ? La veillée familiale ? La veillée commune élargie au voisinage, au gens des hameaux ou du quartier ? La veillée mortuaire ou la veillée de Noël ? C’est dire qu’elle prend les formes les plus diverses.
La fonction de la veillée dans l’ancienne société était bien autre chose qu’un petit moment de bonheur, autre chose qu’un simple lieu de convivialité. C’était aussi un temps de travail, c’était aussi le moment où « l'on faisait cercle », où l’information sur l’actualité locale se faisait naturellement, le moment où l’on racontait des histoires à faire frémir, bref ! Le moment de la parole libérée… Sous l’œil inquiet et sourcilleux des autorités.
La veillée d’autrefois a disparu, mais aujourd’hui à l’instant où tombe la nuit n’existent-ils pas d’autres manières de se réunir ? Le regard sur le passé nous en apprend beaucoup sur le présent et sur nous-mêmes.
Paysan comtois la vie au village au XVIIIe siècle
VIVRE AU VILLAGE AUTREFOIS (XVIIIe-XIXe SIÈCLES)
On pourra se reporter au-delà des ouvrages à quelques-uns de mes articles suivants :
1/ Aspects du clergé paroissial du doyenné de Lons-le-Saunier à la fin du XVIIe siècle, Soc. d’Emul. du Jura, Travaux, 1974.
2/ La culture du clergé jurassien de la fin du XVIIe siècle à la révolution, Soc. d'Emul. du Jura, 1981.
3/ La vie matérielle dans les villages de la région lédonienne au XVIIIe siècle, Soc. d'Emul. du Jura, 1983.
4/ Monitoires et formes de la délinquance dans le diocèse de Saint-Claude, Soc. d'Emul. du Jura, 1985
5/ Le clergé paroissial et la vigne au XVIIIe siècle, Actes du colloque sur L’Église, la vigne et le vin dans le massif jurassien, Cercle Girardot, Lons-le-Saunier, 1991.
5/ Vie et travail dans la Petite Montagne jurassienne du XVIIe au XIXe siècle, les grandes mutations, in La Petite Montagne, 36 pages, (juin 1994).
6/ La vulgarisation agricole, Bulletin de la section d'histoire contemporaine, Laboratoire d'histoire de Besançon, n° 2, 1998.
7/ La Franche-Comté en flammes (XVIIIe -XIXe siècles), Les Amis du vieux Saint-Claude, Bulletin spécial, juin 1999. p. 51-63.
8/ La communauté villageoise : du ciel sur la terre (1750-1850), in A la recherche de la cité idéale, Centre de rencontre Européen, Claude-Nicolas Ledoux, saline royale, catalogue de l’exposition, mai 2 000, p.106-109.
9/ La terre et les hommes en Franche-Comté au temps de Courbet, in catalogue Gustave Courbet et la Franche-Comté, Musée des Beaux-Arts de Besançon 2000, p.13-22.
10/ La paysannerie comtoise de la Révolution à la fin de l’Empire», in Le Consulat en Franche-comté, Société d’Émulation de Haute-Saône, 2002, p.167-188.
11/ Le temps au village : le cas de la Franche-Comté (1750-1850), 129e Congrès national, Besançon, avril 2004, paru 2008 sur CD, CTHS Temps social, temps vécu.
12/ Le curé de campagne dans tous ses états (XVIIIe –XIXe siècles), Généalogie magazine, 2005.
13/ Une paroisse jurassienne et son curé, Sarrogna (1758), Barbizier, Folklore comtois, 2008.
14/ Une paroisse divisée Mouthier-Hautepierre », La raconttote, n° 80, 2007.
15/ La veillée où comment utiliser la nuit, Cahiers Bernon, n°3, 2008, p. 187-195.
16/ L’esprit comtois à travers les proverbes, Jura français, septembre 2011.
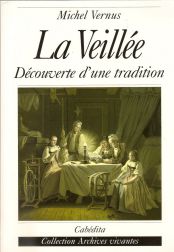
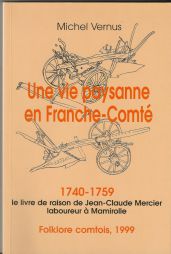
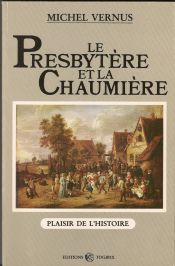
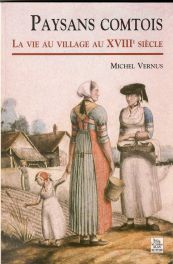
Dans la société comtoise grande est la distance entre la masse paysanne et la petite élite sociale qui s'appuie sur elle et qui vit de son travail.
Depuis des siècles, le paysan comtois est inséré dans un réseau d’usages collectifs qui lui garantissent la survie matérielle : le chauffage commun, la fabrication du fromage commun, la vaine pâture… Il sait instinctivement et d’expérience que seul, livré à lui-même, à mains nues, il ne peut rien.
Cultiver les champs, récolter avec des instruments de faible efficacité n’était pas une mince affaire. Si le travail de la terre absorbait jusqu’à l’épuisement l’essentiel de ses forces, bien d’autres tâches étaient impératives, fabriquer et entretenir l’outillage, préparer le bois pour le foyer, effectuer les corvées au service du Roi et du seigneur…
Au prix d’un dur travail, le paysan tirait la nourriture dont il avait besoin pour reconstituer ses forces, encore lui était-il nécessaire de payer les taxes que les puissants prélevaient sur ses récoltes. Cette vie et ce travail restaient profondément conditionnés par les grandes forces de la nature, les multiples dangers qui pesaient sur les hommes et la terre : la grêle, les chaleurs épuisantes de l’été ou le froid cinglant de l’hiver, les pluies incessantes ou les trop grande sécheresses.
Actualités, publications, conférences, expositions ...
TEXTES ET DOCUMENTS
CONTACT
OEUVRE ARTISTIQUE
OEUVRE LITTERAIRE
AGENDA
ACCUEIL
Michel Vernus
sur l'encyclopédie
internet Wikipédia


Michel Vernus