La société comtoise ancienne est caractérisée par une grande soumission de l'individu et de la famille à la communauté villageoise. Des contraintes communautaires pesaient lourdement. On ne moissonnait pas, on ne faisait pas les foins, on ne vendangeait pas quand on voulait; les soles cultivées ou en jachère étaient réparties par la communauté oblige à respecter. L’homme battu par les femmes était tourné en ridicule par la trottée de l’âne; par ailleurs l’idiot de village était pris en charge par la communauté. Le calendrier religieux s’imposait à tous et à toutes. La vie individuelle et familiale était donc fortement réglée de l’extérieur par la communauté.
LA VIE EN COMMUNION
En Franche-Comté, une originalité était « la vie en communion » c'est-à-dire la famille élargie. Toutefois, le cas comtois ne doit pas faire illusion, il semble bien que la famille étroite a été plutôt la règle dans toute l’Europe occidentale. La famille élargie a existé dans d’autres régions. La famille devenait élargie dans certaines circonstances. On la rencontre dans des régions riches, les grands domaines créaient un besoin de main d’œuvre, mais aussi dans des régions pauvres où la survie rendait nécessaire le regroupement. La misère et l'’appauvrissement dus à des crises étaient favorables à la famille élargie...
En Franche-Comté la vie en communion, comme on disait autrefois, a pour origine non pas seulement le contexte économique, mais aussi un droit seigneurial : la mainmorte. Ce qui est intéressant à relever est le fait que la vie en gros ménage a débordé au-delà des mainmortables ; elle s’est généralisée. Elle était une nécessité à au village où tout se faisait à la main, sans bras la terre ne valait rien. La difficulté de vivre en montagne, le poids de la rigueur climatique, ont joué en même temps que le statut juridique de la main morte, ces deux phénomènes se sont cumulés.
On parlait donc de vie « en gros ménage » ou de vie « en communion ». Le communier est une personne vivant sur des biens indivis. L'expression de « père et fils communiers » dans les actes notariés est très courante. Ainsi que celle de « frères communiers », mariés ou non. Les communiers vivent sous le même toit « à même feu et à même pot ».
Lequinio vers 1800 constate que dans le Grandvaux « père et mère, enfans, petits-enfans, arrière petit-fils, cousins et petits-cousins demeurent ensemble, c'est un arbre généalogique, dont les branches ne se séparent qu'à la longue ». Au XVIIIe siècle, à la campagne, les enfants célibataires ou mariés continuent donc à habiter avec leurs parents.
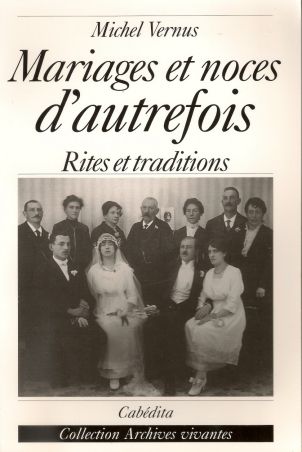
Le système organisait la vie commune des jeunes gens mariés chez les parents de l'un ou de l'autre (le plus souvent chez les parents de l'époux) ; les modalités sont prévues dans les contrats de mariage. Le contrat de mariage est ancien. Au XVIIIe siècle, ce type de contrat est généralisé, l’était-il auparavant ? Les contrats étaient aussi nombreux que les testaments.
La cérémonie religieuse du mariage « qui se fera et accomplira s'il plaît à Dieu, à notre mère Sainte Eglise » selon la formule, était précédée, de plusieurs semaines ou de quelques mois, par la signature d'un contrat de mariage devant le notaire, chez lequel se retrouvaient les futurs, les parents et amis des deux familles. Dans certain cas, dans le Jura bressan par exemple, cette cérémonie avait lieu la veille de la célébration du mariage. L'acte « des conventions matrimoniales » précisait les biens apportés de part et d'autre par les époux, définissait la situation de ceux qu'ils pourraient acquérir dans le futur, en un mot dressait les contours de l'organisation matérielle du foyer.
Les contrats de mariage précisent souvent les dispositions matérielles entraînées par la vie familiale commune. S'il choisit la vie en communion, le jeune couple venait habiter sous le toit des parents du mari. Les parents s'engageaient alors à loger, nourrir, chauffer, blanchir et entretenir les mariés et les enfants à naître. En contrepartie, les nouveaux époux participaient pour une part aux frais (un quart ou tout autre proportion stipulée) ; les revenus des biens dotaux étaient mis dans la communion, après reconnaissance de leur montant, ils gardai cependant leur individualité. Quant aux acquisitions à venir, généralement, elles étaient partagées par moitié. Si, par la suite, la vie devenait intenable, le jeune couple désirai partir, les clauses prévoyaient en ce cas, que les parents lui conféraient : argent, habits, trousseau (lit et accessoires) pour leur établissement ; un artisan promettait par exemple à son fils de lui remettre les outils indispensables à son état.
Il est inutile d'insister sur le fait que l'intimité était naturellement très faible dans ce type de famille en gros ménage.
LE RÔLE DE LA PARENTÉ
La parenté dans un monde difficile et dangereux formait un ensemble de solidarités complémentaires qui se trouvaient insérées dans d’autres solidarités, celles de la communauté villageoise notamment.
Les solidarités complémentaires n’étaient pas de trop dans un monde hostile. A l’intérieur de ces solidarités, la solidarité de parenté était certainement beaucoup plus forte qu’aujourd’hui, car l’ancienne société ne connaissait pas les systèmes de protection les services sociaux mis en place plus tard par l'État contemporain. C’est rappelons-le, lorsque l'État était faible, que les solidarités, la solidarité de parenté notamment, jouent un rôle de protection plus fort, plus utile. En haut comme en bas dans la société. Le rôle de la famille change dans le temps en fonction des situations.
La famille était un refuge. Dans la noblesse, les membres étaient obsédés par leurs ancêtres, leur généalogie : car la famille était une solidarité à la fois d’honneur, d’intérêts, de puissance et de pouvoir.
Au village, la parenté était pour les plus pauvres un instrument de survie, orphelins recueillis, les branches les plus riches embauchaient souvent les enfants des branches les plus pauvres etc... certains bien traités, d’autres moins bien.
SURVIVANCE DE « LA VIE EN GROS MÉNAGE » AU XIXE SIÈCLE
Les trois frères Chauvin en 1838 exploitaient en fermiers indivis, une ferme louée par bail de 9 ans, régulièrement renouvelé. Cette ferme appelée Chaux-Denis, isolée à 700 m d’altitude sur le deuxième plateau du Jura, s’étendait sur près de 92 hectares. En 1860, les trois frères renouvelèrent leur bail. Les trois frères sont mariés, à eux trois ils ont 16 enfants.
Ces trois familles qui n’en font qu’une, comprenait 22 personnes auxquelles il faut ajouter deux bergers et parfois des servantes. Pour l’instruction des enfants, une institutrice était engagée à demeure. Chacun des frères avait sa spécialité, l’aîné s’occupait du gros ménage, le cadet courait les foires, le plus jeune s’occupait des bêtes et de la basse-cour. Les dix garçons eux effectuaient les travaux artisanaux dont le groupe avait besoin, l’un s’occupait de la fabrication des fromages, un autre faisait le forgeron, un autre travaillait le cuir, un autre encore s’occupait du matériel agricole.
Ainsi Organisé le groupe était autonome. Toutefois enfermé dans ce type de structure, le groupe ne vivait pas en dehors du progrès agricole, tout au contraire, il utilisait le machinisme nouveau (par exemple charrue Domsbale, machine à battre à manège...) Comme l’ensemble de l’agriculture comtoise, cette famille à partir de 1850 fait le choix de l’élevage laitier, elle a 42 mères-vaches, fabrique des fromages de 25 kilogrammes, la production totale étant d’environ 6 000 kilogrammes annuels. Enfin, la ferme participait aux concours agricoles et obtenait des jurys des médailles et des primes.
UNE VISION MONARCHIQUE DE LA FAMILLE
Les autorités civiles et religieuses avaient une vision monarchique du gouvernement familial. Celle-ci remonte loi dans le temps.
La vision chrétienne en était une des racines : « Tes Père et mères honoreras » ; saint Paul, véritable fondateur de l’Église disait déjà : « femmes, enfants serviteurs doivent obéir aux maîtres de maison ».
L'autorité du Père servait à légitimer toutes les autres autorités celle de Dieu (un père), celle du Roi « père de la nation ». Toute autorité était paternelle! Avec un double aspect : le père est l'autorité, voire l'autoritarisme mais aussi la protection.
Dans la famille comtoise, l’autorité paternelle n'était pas un mot creux. Ce qu’il faut retenir de cet examen rapide des liens familiaux : les deux groupes dominés : les femmes et les jeunes ont réussi tout de même à préserver des espaces de liberté et de convivialité, lesquels pouvaient parfois se transformer en espaces de résistance.
1/ les femmes, mineures juridiques s'aidaient entre voisines. Le lavoir était un espace féminin. A la fontaine, à la veillée, sur le pas de leurs portes, groupées elles savaient se faire entendre. Il existait une sorte d’entraide entre elles, lors des accouchements, lors des baptêmes, des décès....
2/ De la même façon, on ne saurait trop insister sur le rôle des groupements de jeunesse au village: les jeunes avaient leur organisation propre avec leurs rituels ; ils étaient capables de peser lors de chahuts (charivari) ou comme organisateurs de manifestations rituelles: les pois frits (le picquerey), les Mais placés sous les fenêtres des jeunes filles. Ils se manifestaient lors des mariages avec le « rituel de la table » pour obtenir quelques pièces des futurs mariés...
Pour l'un et l'autre groupe , il existait donc sous le couvercle de l’autorité maritale et paternelle des soupapes de sécurité.
Outre mon ouvrage, on peut consulter sur ce thème
1/ La vie comtoise au temps de l'Ancien Régime, Tome I et II, Lons-le-Saunier, 1983 et 1984, 270 et 253 p.
2/ Paysans comtois, La vie au village, Sutton, 2004, 191 p, chap. VII Se marier, p. 115-130.
3/ Une vie paysanne en Franche-Comté, le livre de raison de Jean-Claude Mercier (1740-1759), Folklore comtois, 2 000, 180 p.
4/ Stratégie familiale au presbytère, Gé-Magazine, n°39, 1986.
5/ Le mariage en Franche-Comté au XIX e siècle, in Epousailles, catalogue d'exposition au musée de Champlitte, juin 2013, p. 49-64.
6/ Dans L’œil de Léon, La vie au village, éd. des Presses du Belvédère, 2005, on trouvera des éléments d'analyse des photos de mariage.
ASPECTS DE LA FAMILLE EN FRANCHE-COMTE
Actualités, publications, conférences, expositions ...
TEXTES ET DOCUMENTS
CONTACT
OEUVRE ARTISTIQUE
OEUVRE LITTERAIRE
AGENDA
ACCUEIL
Michel Vernus
sur l'encyclopédie
internet Wikipédia


Michel Vernus